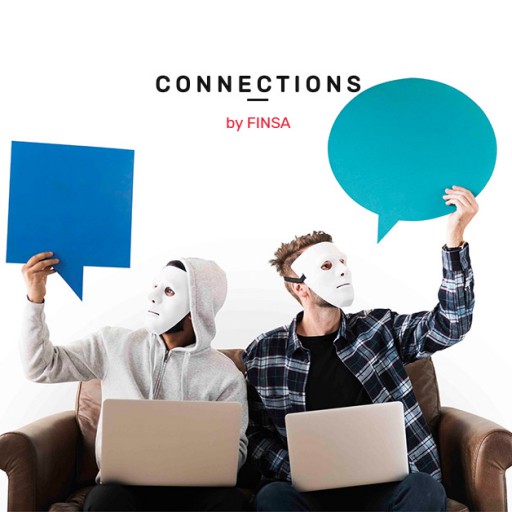Paula Camiña est ingénieure en Design Industriel et Développement de Produit et experte en biodesign, discipline dans laquelle elle s’est formée via le master spécifique proposé par la Central Saint Martins University de Londres. En fait, Paula Camiña faisait partie de la toute première promotion de ce master à une époque où il n’était pas possible de se spécialiser en biodesign ailleurs. Son projet final était « Co-Obradoiro Galego », pour lequel elle a collaboré avec trois vanniers pour rechercher des biomatériaux qui aideraient à sauver la technique traditionnelle. Le projet se poursuit à travers des cours et des conférences, tandis que Camiña le combine avec son travail dans une entreprise londonienne de cosmétiques naturels à base d’algues.

Comment le biodesign est-il entré dans votre vie ? Qu’est-ce qui vous a attiré vers la discipline pour vous y spécialiser ?
Alors que j’étudiais l’Ingénierie de Conception Industrielle et le Développement de Produit à l’École universitaire de Design Industriel de Ferrol (Espagne), j’ai réfléchi à la manière dont je pouvais ajouter de la valeur au développement d’un nouveau produit, d’un nouvel objet ou d’un objet existant. À partir de cette question, pour moi la réponse était dans sa matérialité. C’est à ce moment-là que j’ai découvert la discipline du biodesign. Je cherchais également des masters et je suis tombé sur un article sur Deezen qui parlait d’un nouveau master axé sur le biodesign à Central Saint Martins à Londres. J’avais déjà suivi un cours dans cette université l’année précédente, donc je connaissais le centre et j’étais intéressée pour y étudier ce sujet. J’ai fait partie de la première promotion du master en biodesign au niveau mondial ; il n’y avait à ce moment pas d’autre type de formation dans la discipline.
Votre projet de thèse de master était « Co-Obradoiro Galego », dans lequel vous avez utilisé la bioconception et les biomatériaux issus de coquilles de crustacés ou d’algues dans une technique traditionnelle comme la vannerie. Comment cette idée est-elle née ? Comment s’est déroulé le processus de développement ?
Le projet final du Master m’est parvenu en 2020, lors du premier confinement, alors que j’étais en Galice. J’ai commencé par une recherche scientifique, c’est ainsi que naissent les projets de biodesign, mais avec beaucoup d’intérêt pour les matériaux flexibles, qui, je ne sais pas pourquoi, ont toujours été ma passion. Au cours de ce processus, j’ai découvert des projets que l’architecte Neri Oxman développait au MIT, qui exploraient des structures de grand format, flexibles et ayant cette origine biologique. Sur la base de ces recherches scientifiques existantes et ne sachant pas si je pourrais retourner à Londres et avoir accès au laboratoire, j’ai décidé de donner au projet une approche locale, en me concentrant sur l’étude des déchets de la région, comme les coquilles de coquillages, qui montraient déjà un potentiel pour le développement d’un biomatériau flexible.
Ver esta publicación en Instagram
Cela m’a amenée à avoir des conversations avec des gens qui travaillent quotidiennement avec la mer : corporations de ramasseurs de coquillages, pêcheurs, entreprises de pêche… Là, j’ai pu apprendre de leur expérience et aussi comprendre les enjeux de leur quotidien et découvrir les outils. Le lien entre ces conversations et la vannerie a commencé avec les pots. J’ai vu les vieux paniers en bois et je les ai trouvés très jolis, c’est ce qui a suscité mon intérêt pour la vannerie. Ces dernières années, cet artisanat a dû être réinventé, car le bois d’eucalyptus et de pin, prédominant dans nos montagnes de Galice, n’est pas compatible avec les techniques traditionnelles de vannerie à lattes. C’est de là que vient l’idée d’introduire ce nouveau matériau fabriqué à partir de coquilles de coquillages, suivant les mêmes principes que la vannerie : utiliser un matériau local et flexible. Nous avons ensuite réalisé une deuxième collection avec un biomatériau issu d’algues. J’ai passé de nombreux jours à enregistrer et à concevoir les pièces dans trois ateliers de vannerie, ceux de Rubén Berto, Enrique Táboas et Carliños González. Dans la phase finale, de retour à Londres, j’ai développé le matériel dans le laboratoire universitaire.
Pensez-vous que le biodesign peut être un moyen de sauver les techniques traditionnelles ?
Le sauvetage est peut-être un peu trop important. Mais je crois que le biodesign peut jouer un rôle clé dans l’évolution des techniques traditionnelles. On a tendance à l’associer à des idées futuristes qui nécessitent des laboratoires ultra-avancés, mais je crois que le biodesign a beaucoup à apprendre des métiers traditionnels. Souvent, les réponses à ces questions que nous nous posons en tant que designers se basent sur des connaissances qui existent déjà et qui ont été travaillées en harmonie depuis longtemps, depuis de nombreuses générations.
Que peut apprendre le biodesign des techniques traditionnelles comme la vannerie ?
Par exemple, la vannerie s’appuie sur des ressources locales et des processus de production durables qui transforment un morceau de bois en une feuille qui nous permet de tisser. Ce processus est reproduit dans la bioconception. Il s’agit de comprendre les ressources locales qui nous entourent et de voir comment nous pouvons transformer les déchets, comme les coquilles de crustacés, en quelque chose qui peut ajouter de la valeur à une autre communauté. Dans le projet « Co-Obradoiro Galego », les déchets de l’industrie marine sont transformés en un matériau précieux pour la vannerie tressée.
Ver esta publicación en Instagram
Vous travaillez désormais chez Haeckles, une entreprise qui fabrique des cosmétiques naturels à partir d’algues. Quel est votre rôle ?
Ma position est celle d’un leader en biodesign. Je réalise la partie innovation à travers les matériaux, qui peuvent prendre forme de différentes manières, depuis le développement du produit, la compréhension du produit comme emballage ou les produits eux-mêmes. Mon premier projet, par exemple, a été de développer un verre comestible pour un environnement de festival qui n’aurait aucun impact environnemental. Ce que j’ai fait, c’est développer un matériau qui était à la fois comestible et compostable, qui répondait aux exigences utilitaires de pouvoir servir de verre et contenir de la glace, tout en ayant un bon goût et une valeur esthétique.
Le biodesign est-il toujours durable ?
Oui. Pour moi, le biodesign est une discipline au sein du domaine du design dans laquelle les principes scientifiques sont appliqués à une spécification. L’une des conditions est la durabilité. Si l’on part du principe que non seulement son origine doit être biologique, mais aussi les méthodes utilisées dans son développement, il existe en soi une relation entre biodesign et durabilité. Il y a aussi un facteur très important sur lequel j’insiste toujours : la différence entre un modèle durable et un modèle régénératif. Il s’agit d’aller plus loin et non seulement de réduire l’impact négatif, mais aussi de favoriser sa régénération. C’est l’idée dont je parlais tout à l’heure selon laquelle nous pouvons transformer les déchets en une ressource précieuse.
Ver esta publicación en Instagram
Pensez-vous qu’il y a un rôle à jouer pour les matériaux traditionnels comme le bois ?
Bien sûr. Le bois peut continuer à jouer un rôle clé. La bioconception doit commencer par considérer les matériaux qui existent déjà dans notre environnement et nous devons les remplacer par d’autres seulement si les nouveaux apportent réellement une valeur environnementale significative. Dans le projet « Co-Obradoiro Galego », nous faisons la promotion d’un équilibre et d’une synergie entre le traditionnel et l’innovant, en combinant des matériaux traditionnels comme le bois avec de nouveaux matériaux. Nous relions donc cette idée du passé avec le futur.
À quels défis le biodesign est-il confronté et que faut-il pour qu’il devienne courant ?
Le biodesign est étroitement lié à l’innovation, qui implique toujours de faire face à une série de défis techniques lors de la création de ces nouveaux systèmes de production de matériaux. Il s’agit d’un niveau considérable de recherche et de développement. Mais en même temps, ces procédés, qui peuvent être coûteux et difficiles à reproduire à grande échelle, montrent la possibilité de devenir une technique courante. Je crois qu’en fin de compte, le changement qui doit être réalisé réside dans notre façon de consommer : adopter un modèle plus durable ou un modèle régénérateur dans lequel nous consommons moins et qui permet une production plus efficace, efficiente et respectueuse de l’environnement.
Vous restez lié à l’université par l’enseignement. Qu’en avez-vous appris ?
Deux mots clés me viennent à l’esprit : respect et empathie.
D’où tirez-vous votre inspiration quotidienne ?
Je suis une personne très curieuse. Je pense que la curiosité, et aussi la sensibilité que j’ai, me font m’inspirer de tout ce qui m’entoure. Cette curiosité m’amène également à avoir des conversations constantes avec des personnes ou des entreprises qui partagent des valeurs et des intérêts similaires. Je suis également inspirée par l’observation de la façon dont les gens se rapportent à leurs objets du quotidien. Une autre source d’inspiration se trouve dans les livres, comme celui que je lis en ce moment, Fewer Better Things, de Glenn Adamson. La réflexion sur la façon dont nous nous rapportons aux objets qui nous entourent dans notre vie quotidienne et sur la façon dont nous les valorisons a été essentielle ces dernières années.
Votre travail est certainement basé sur un engagement profond en faveur de la durabilité et du respect des choses locales. Quelles sont vos valeurs en tant que biodesigner ?
Lorsque j’ai une présentation, je commence toujours par trois valeurs qui proviennent de références à la fois galiciennes et mondiales et qui définissent mon travail dans le projet « Co-Obradoiro Galego ». La première concerne le lien avec nos origines et nos racines et vient du Laboratorio de Formas : « Une œuvre doit être enfant de son temps, mais elle ne doit pas ignorer d’où elle vient ». La deuxième porte sur l’honnêteté et l’innocence, elle est de Rick Rubin : « L’innocence donne naissance à l’innovation. Le manque de connaissances peut ouvrir davantage de possibilités d’explorer de nouvelles voies. C’est avec cette innocence que je me suis approchée des vanniers, avec l’idée que je ne savais pas et en ayant la curiosité et le courage de poser des questions. Le dernier porte sur la collaboration et est signé Soetsu Yanagi : « … Un monde où la qualité est garantie par l’effort collectif. »