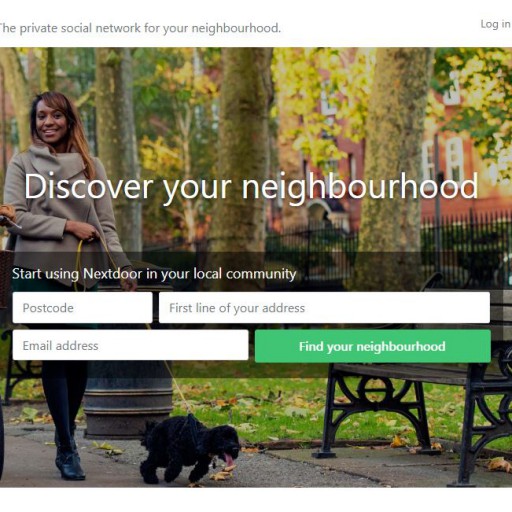Chaque fois qu’elle doit démarrer un projet, l’architecte devenue photographe María Azkarate se plonge dans la lecture et la recherche pour apprendre et donner à l’idée une substance conceptuelle. C’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a été contactée pour participer à l’une des salles du Pavillon espagnol à la Biennale d’architecture de Venise. Le résultat, un essai visuel sur la chaîne de valeur du bois. Nous avons discuté avec elle de ce projet, de la manière dont elle trouve l’inspiration et de ses troisièmes paysages.

Vous participez en tant que photographe au Pavillon espagnol de la Biennale d’architecture de Venise, Internalities, avec un essai visuel pour la salle Matériaux. Comment avez-vous été amenée à participer à ce projet ?
Roi Salgueiro et Manuel Bouzas, les conservateurs généraux du Pavillon espagnol, m’ont contactée par e-mail pour me faire part de leur idée. Ils voulaient m’inclure dans une des salles, la salle des matériaux. Je l’ai reçu avec beaucoup de surprise et de joie. Bien sûr, j’ai dit oui. Cela a également été un processus d’apprentissage, car je ne suis pas une experte du bois.
Comment avez-vous abordé votre travail, qu’avez-vous fait exactement ?
La partie conceptuelle était sous la responsabilité des commissaires de la salle, Dani Ibáñez et Carla Ferré. Mon travail a davantage été celui de donner une expression visuelle aux idées sur lesquelles ils travaillaient. Grâce à une communication bidirectionnelle et à un peu de soutien de la part des endroits qu’ils m’ont suggérés, j’ai essayé de trouver un moyen de construire un récit, de transmettre ces idées. Dans la salle Matériaux, on parle de l’importance que le bois peut avoir dans la décarbonisation de la construction. Ils proposent une installation au centre de la salle dans laquelle ils abordent quatre thématiques liées à l’utilisation du bois en architecture.
Mon histoire porte davantage sur la chaîne de valeur elle-même, de la forêt au bâtiment construit, et sur tous les processus impliqués dans la transformation du bois. L’objectif était de donner une expression visuelle au parcours du bois depuis la matière première, depuis la pépinière elle-même – sachant que le bois est cultivé – jusqu’à un bâtiment public en activité.
Vous avez dit auparavant que vous aviez beaucoup appris. Qu’avez-vous retiré de tout cela ?
Sur le plan personnel, j’ai aimé pouvoir raconter quelque chose comme ça. Le bois a un potentiel de transformation et un certain rôle à jouer dans un changement de paradigme dans la construction, où l’objectif n’est pas seulement la décarbonisation, mais aussi de garantir que le processus de transformation des matériaux soit circulaire et local, garantissant que les forêts soient préservées avec tous les avantages qu’elles apportent à la culture et à la société.
Vous êtes photographe, mais vous avez commencé comme architecte. Comment avez-vous fait ce changement ? Quel a été le chemin de vie qui vous a conduit là ?
J’ai étudié l’architecture et j’ai travaillé comme architecte pendant les premières années. J’avais mon propre atelier, je faisais de l’architecture… Mais ensuite la fameuse crise de 2008 est arrivée et le travail est devenu rare. De plus, je venais d’avoir des enfants, c’était une période de changement. Durant cette pause, j’ai commencé à m’intéresser à la photographie. Soudain, j’ai réalisé que ce que j’avais vu dans les magazines pendant toutes mes années de formation n’était pas des bâtiments, mais des photographies. J’avais visité des bâtiments, mais il y avait aussi une partie à l’intérieur, qui est la communication de l’architecture. Cela m’a accroché. Vous ne savez pas vraiment comment ces choses fonctionnent. C’est comme le chant d’une sirène : quelque chose vous attire, vous tirez sur le fil, et à chaque fois vous devenez plus intéressé et accroché. Ma formation a été très autodidacte et assez lente, mais elle a été constante.
Ver esta publicación en Instagram
Avec cette formation préalable, on pourrait penser que vous ne faites que de la photographie d’architecture.
Je fais de la photographie d’architecture sur commande, mais en 2016, j’ai commencé à faire davantage de projets d’auteur. Je me suis inscrite à un cours de photographie avec Carlos Cánovas, un photographe de Pampelune, et avec lui j’ai appris qu’il y avait une autre façon de prendre des photos. Dès cette première rencontre avec la photographie d’auteur, il m’est arrivé la même chose : quelque chose qui m’appelle et que je trouve très attrayant dans cette façon d’aborder l’image. C’est vrai que j’ai travaillé sur pas mal de commandes institutionnelles ces derniers temps, comme celle de Venise, mais il y a d’autres projets dans lesquels je suis aussi impliquée, qui ne sont pas encore publics, et puis il y a une œuvre qui a été mon premier projet d’auteur, qui est Tercer Paisaje.
Tercer Paisaje a été la lauréate 2020 du BAFFEST, le concours destiné aux femmes photographes basques émergentes au Barakaldo Women Photographers Festival. En quoi consistait le projet ?
Dans l’idée d’architecture élargie ou de territoire et d’architecture comme manifestations différentes d’une même dynamique, je me positionne sur deux points apparemment contradictoires, mais qui créent une certaine tension : l’espace poétique – la dimension poétique, corporelle, expérientielle de l’architecture – et le paysage politique, qui serait cette approche du territoire depuis la perspective conceptuelle, sociologique, politique. Dans cette tension, entre ces deux pôles, se trouve tout mon travail.
Dans ce spectre entre deux pôles, Tercer Paisaje se situe bien du côté du conceptuel, du discursif, du territorial, car en fait l’architecture n’apparaît pas. Le troisième paysage est celui des espaces résiduels de l’aménagement du territoire, selon le manifeste de Gilles Clément, jardinier et paysagiste français. Ce sont des espaces d’incertitude dans lesquels rien ne peut arriver parce que, fondamentalement, ils ne sont pas adaptés à ce qu’il se passe quoi que ce soit. Mais ce sont aussi des espaces d’une richesse botanique particulière, ce sont des réserves de biodiversité. C’est un changement de paradigme, un changement dans la façon de penser ce qui arrive aux choses si nous n’agissons pas en conséquence. Mon projet est une approche photographique de cette pensée, de cette approche de mise en valeur de la beauté qui se trouve dans ces marges.
En vous écoutant parler, il est clair que votre photographie est fortement influencée par l’architecture et les réflexions sur le territoire, le paysage et les espaces, mais l’inverse s’applique-t-il également ? Avez-vous remarqué que vous voyez les choses différemment – les bâtiments, les espaces – depuis que vous avez commencé à prendre des photos ?
Oui bien sûr. Nous, les architectes, avons tendance à toucher les choses. Souvent, vous savez que quelqu’un est architecte parce qu’il regarde un mur de briques, le caresse et médite sur cette surface spécifique. Je suppose que la même chose se produit en photographie, vous commencez à regarder peut-être non pas tant la matérialité des choses, mais la lumière et son pouvoir expressif. Je suis très intéressée par l’espace photographique, et l’une des choses que je dis souvent lorsque j’enseigne est que l’architecture et la photographie ont en commun le fait qu’elles créent toutes deux des espaces. Bien que la photographie soit composée de couleurs et de formes sur un plan, elle construit en réalité ce genre d’illusion spatiale. Maintenant, mon approche de l’architecture a beaucoup à voir avec la façon dont je pourrais faire cette traduction de l’espace architectural vers cet autre espace photographique. Comment puis-je construire une séquence ? Comment puis-je traduire cela en une image qui n’est peut-être pas seulement visuelle, mais multisensorielle ?
Ver esta publicación en Instagram
Quel est le processus dans vos projets d’auteur ? Qu’est-ce qui vous amène à dire « la prochaine chose portera sur cela » ?
Mon processus, qu’il s’agisse d’une commande ou d’un projet que j’ai commencé seule, est généralement assez similaire, car je travaille beaucoup à partir du mot. Les projets comportent une phase initiale de chargement conceptuel, de nombreuses lectures. Après tout ce brainstorming, il y a un processus de distillation que je fais généralement en synchronisation avec la capture d’image. Disons qu’il y a un processus de la pensée à l’image, puis de retour à la pensée, puis de nouveau de retour à l’image pour qu’à la fin cette image, dans la mesure du possible, soit capable de transmettre un sens, en comprenant toujours que celui-ci ne sera pas univoque, qu’il sera ouvert. Oui, je pense que la réflexion préalable amène l’image vers des endroits imprévus, ce qui est une façon d’éviter les clichés, car comme vous essayez de raconter une histoire très spécifique, en essayant de forcer l’image à s’approcher de quelque chose qu’elle a du mal à faire, vous trouvez des formes d’expression visuelle imprévues.
Et puis il y a le texte. Parce que ce genre d’opacité de l’image peut devenir un peu plus transparente lorsqu’il y a une petite déclaration, lorsqu’il y a un texte qui fournit quelques clés de lecture qui aident à comprendre le cadre conceptuel. Dans cette rencontre entre le mot et l’image, de nouvelles formes de narration apparaissent. Les significations et une série d’autres questions qui ont trait au poétique, au symbolique, au corporel se multiplient.
Depuis 2024, vous donnez également des cours. Comment votre vision de la photographie a-t-elle évolué depuis que vous devez l’expliquer à vos étudiants ?
C’est un lieu commun : je ne sais pas si mes élèves apprennent dans mes cours, mais j’apprends dans mes cours. La parole est quelque chose qui fait partie de ma façon d’être au monde. J’ai besoin de nommer les choses, je suis très analytique. C’est un avantage en terme d’enseignement.
De plus, je trouve les processus d’apprentissage merveilleux. Je crois que rien ne nous appartient, dans le sens où je sais ce que je sais parce que quelqu’un me l’a appris, et je suis autodidacte. Mais parce que quelqu’un a écrit un livre, parce que quelqu’un a publié un blog, parce que quelqu’un a fait un tutoriel, parce qu’il y a une circulation de la connaissance, nous pouvons tous apprendre. Cela me semble presque un acte de justice que les autres apprennent de vous ce que vous avez appris des autres.
Ver esta publicación en Instagram
Y a-t-il un projet dont vous êtes particulièrement fier ?
Tercer Paisaje me tient particulièrement à cœur et je continue à y travailler, il est toujours ouvert. De plus, c’est un projet que j’ai lancé de ma propre initiative et dans lequel j’ai développé de nombreux outils que j’utilise aujourd’hui dans le cadre de missions institutionnelles et d’autres projets. C’était aussi mon premier projet d’auteur et j’avais cette approche presque intime de faire ce que l’on veut parce que l’on le veut. Personne ne me connaissait. J’avais l’habitude d’aller dans les terrains vagues de Pampelune pour prendre des photos, cueillir des fleurs… Et pendant la pandémie aussi, j’allais sortir les poubelles, et comme j’habitais en périphérie et qu’il y avait un espace ouvert à côté des conteneurs, je cueillais des fleurs et je prenais des photos. Tout cela de manière très anonyme et sans aucune attente, juste l’amour du travail et de cette richesse et complexité qu’il me semblait avoir.
Comment vous en sortez-vous avec les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux sont un espace dans lequel il faut être présent, et je les utilise principalement comme un espace de visibilité, comme un espace pour promouvoir mon travail. Et aussi pour découvrir le travail des autres acteurs. Ma première utilisation des réseaux est justement formatrice. Comme c’est un espace où les gens montrent ce qu’ils font, montrent leurs pensées, c’est aussi un réseau de connaissances. Si vous êtes consciencieux, vous pouvez trouver beaucoup de choses très précieuses. Cela me semble être une révolution absolue et il me semble qu’il y a des choses extraordinaires dedans.
D’où tirez-vous votre inspiration quotidienne ?
Du désir. En 2018, j’ai fait un atelier avec la photographe Awoiska van der Molen, qui disait que la question à laquelle nous devions répondre en tant que photographes était : qu’est-ce qui vous fascine ? Et cela est étroitement lié au désir. Je crois que la plus grande motivation que nous pouvons trouver est le désir, compris comme curiosité. C’est ce que je disais avant, que soudain quelque chose vous appelle, le chant des sirènes. Quand quelque chose pique ma curiosité, quand quelque chose me demande de creuser un peu plus, d’aller un peu plus loin, c’est ce qui me pousse à explorer dans cette direction, à consacrer le temps nécessaire pour que les choses mûrissent. Donc, pour moi, l’inspiration réside dans le désir, dans cette sorte de rencontre avec les choses où elles ont soudainement un sens intime et activent la volonté.