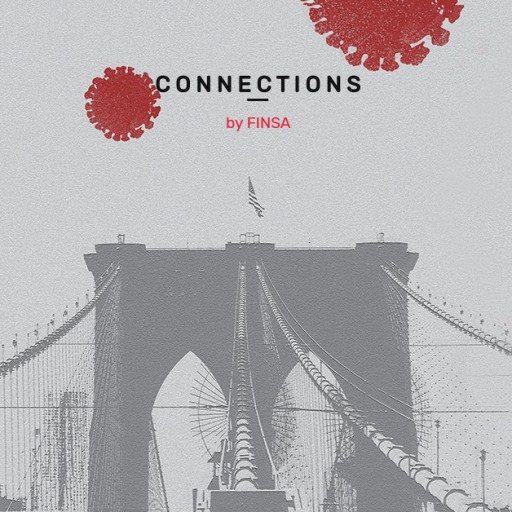L’un des grands défis de ce siècle est la répartition de la population : plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des zones urbaines et cette tendance devrait se poursuivre. Cela laisse une grande partie du territoire abandonnée et l’on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux : moins il y a de personnes vivant dans les zones rurales, moins il y a de services et d’emplois, ce qui à son tour pousse davantage d’habitants à migrer vers les villes.
Établir une population dans ces zones non urbaines – la faire travailler et s’enraciner – est la clé d’un avenir durable. Dans ces zones rurales, il existe une grande opportunité : les espaces forestiers, les surfaces couvertes de forêts ou de végétation arborescente. Investir dans leur développement donne envie de rester.
“Le développement forestier contribue au peuplement en faisant la promotion d’un modèle durable et diversifié qui combine la conservation de l’environnement avec de nouvelles opportunités économiques”, explique la Fondation RIA, une agence indépendante à but non lucratif qui contribue en Espagne à la recherche, à l’analyse et à la planification territoriale stratégique de la Galice. Dans le cas spécifique de la Communauté autonome dans laquelle ils opèrent, ils soulignent que la valorisation de leurs forêts implique également “de dépasser les modèles traditionnels d’exploitation forestière, basés sur la monoculture pour la production de cellulose et de panneaux et dérivés du bois, pour ouvrir la porte vers une diversification économique, combinant l’exploitation forestière avec la mycologie, la production de résine ou l’élevage extensif, entre autres”.
Ver esta publicación en Instagram
Grâce à cette approche, des opportunités d’emploi sont générées pour les jeunes et la population locale dans les zones rurales et des activités économiques innovantes et durables sont créées. Comme exemple d’initiatives de ce type promues par la Fondation elle-même, ils citent le Laboratorio Ecosocial do Barbanza, lancé en 2020 en collaboration avec l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle et la Fondation Banco Santander. À travers ce laboratoire, soulignent-ils, “nous comprenons le rôle important que les hommes ont joué historiquement dans l’organisation du territoire, mais surtout des communautés qui les habitaient, qui géraient activement les écosystèmes dans une perspective globale, avec une approche circulaire axée sur sur l’utilisation des déchets”.
Des années plus tard, ils ont déjà tiré plusieurs conclusions du projet, comme par exemple le fait que “la gestion des terres et la gouvernance doivent être considérées ensemble dans la planification pour lutter efficacement contre les défis climatiques et démographiques auxquels nos zones rurales sont confrontées”. Une autre leçon est que les investissements sur le territoire ne doivent pas être passifs, mais plutôt pensés pour “promouvoir une activation durable dans le temps, favorisant la création d’emplois qualifiés, sédentarisant la population et assurant la qualité de vie dans les zones rurales”. Enfin, ils soulignent les risques liés à “des évaluations superficielles basées sur des données et des statistiques mondiales” et l’importance d’aborder l’échelle des communautés et des écosystèmes “dans l’intention de promouvoir des solutions concrètes à des problèmes concrets”.
L’importance des communautés locales
Bien que fixer la population signifie aussi attirer des étrangers, l’un des principaux objectifs est d’assurer que ceux qui vivent déjà dans ces zones ne partent pas, qu’il y ait des emplois et des opportunités, que la seule option soit une fois en âge de travailler ou après avoir terminé leurs études ne soit plus d’aller chercher une vie ailleurs. Pour y parvenir, il est essentiel que les initiatives de développement forestier impliquent les communautés locales.
“Les communautés possèdent des connaissances précieuses transmises de génération en génération : les meilleures pratiques agricoles, les saisons et les rotations appropriées, les utilisations historiques des terres, les traditions ; autant d’éléments fondamentaux pour la conception d’initiatives durables, efficaces et adaptées à l’environnement”, convient la Fondation RIA.

Cette implication des entités locales et des communautés de montagne est l’un des objectifs de Panda da Dá, un autre projet de la Fondation RIA en collaboration, dans ce cas, avec Finsa. “Cet espace est conçu comme un point de rencontre pour les activités de recherche et de gestion territoriale, telles que la foresterie, les certifications d’élevage, l’extraction de résine ou la recherche mycologique, favorisant le potentiel du secteur forestier et renforçant la collaboration avec les communautés. En outre, il est prévu que le bâtiment soit un lieu de visites ouvert à différents publics, y compris les clients de l’entité, ce qui renforce son rôle de modèle de développement et de participation », soulignent-ils.
Histoires de réussite en matière de développement forestier
Même si bon nombre de ces projets en sont encore à leurs premiers pas, les politiques et initiatives de développement forestier visant à promouvoir des modèles de gestion durable ne sont pas nouvelles. La Fondation RIA cite comme exemple la région allemande de Bavière qui se distingue par l’utilisation de ses ressources naturelles grâce au développement d’universités techniques de sciences appliquées et d’une formation professionnelle exemplaire étroitement liée à son industrie.
Dans un pays comme l’Allemagne, qui publie depuis 1984 un rapport annuel sur l’état de ses forêts et prend depuis 2008 des mesures pour garantir que ses forêts survivent au changement climatique, cela n’est pas totalement surprenant. En Suisse, ils sont également devenus une référence dans l’utilisation du bois comme matériau d’avenir, ajoute la Fondation.
Si l’on revient en Espagne, la communauté montagnarde de Baroña, à Porto do Son, est pionnière dans la diversification des usages de la montagne. “Depuis le grand incendie de 2006, Baroña a opté pour un modèle d’usages diversifiés qui génèrent des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Sa gestion comprend la production de bois, de résine, les pâturages, l’apiculture, l’élevage et la collecte mycologique. De plus, ils organisent des activités de sensibilisation telles que des itinéraires archéologiques, des ateliers et des cours. Ces initiatives renforcent son modèle de durabilité tout en faisant la promotion du tourisme et de la conservation de l’environnement”, expliquent-ils à la Fondation RIA.
Ver esta publicación en Instagram
Toujours en Espagne, en Galice, la communauté de Montes do Carballo, à Friol, combine la gestion forestière avec l’élevage extensif de chèvres, de chevaux galiciens de race pure et de porcs celtiques, dont la viande est commercialisée par la communauté elle-même, renforçant le kilomètre zéro. De plus, ils favorisent la collaboration avec les agriculteurs locaux. “Vingt des quarante membres de la commune possèdent des fermes d’élevage et utilisent les prairies communales pour le pâturage”, note la Fondation RIA. « La paroisse est aussi profondément impliquée dans les activités de montagne, y compris des événements tels que l’emblématique Rapa das Bestas de Carballo et d’autres célébrations gastronomiques ».
Les défis du développement forestier
Pour parvenir à cet avenir dans lequel les forêts et les montagnes ne seront plus des zones oubliées et livrées à leur sort, il est nécessaire de relever une série de défis. Dans le cas de la Galice – bien que la plupart de ces points puissent être extrapolés à d’autres zones forestières du monde – la Fondation RIA énumère les éléments suivants :
Manque de gestion active sur de vastes zones du territoire
C’est le résultat de cet afflux constant de population vers les villes, qui a provoqué “la disparition des exploitations familiales et le manque de continuité générationnelle”. L’abandon de nombreuses forêts en raison de cette situation entraîne, par exemple, un risque accru d’incendies de forêt. “Des initiatives telles que la gestion coopérative des forêts et des projets innovants, ou le Laboratoire Écosocial de Barbanza, démontrent le potentiel des modèles qui favorisent la multifonctionnalité et la gestion collective du territoire”, souligne la Fondation RIA.
Trouver l’équilibre entre exploitation économique et respect de l’environnement
Dans ce cas, assure la Fondation, « la recherche et la formation jouent un rôle clé dans l’établissement de modèles durables pouvant être adoptés par différentes communautés ».
La professionnalisation du secteur forestier
Si nous voulons dépasser ces façons de faire traditionnelles et parvenir véritablement à un modèle durable, il est nécessaire de faire de grands progrès dans la professionnalisation du secteur. “La mise en œuvre de certifications, de cours et d’ateliers peut accroître l’intérêt et l’implication des citoyens, renforçant ainsi la perception du secteur comme une activité économique viable et durable”, expliquent-ils.
Favoriser les liens entre le secteur forestier et les autres activités
Grâce à cela, les opportunités économiques sont diversifiées, préparant le terrain pour de nouvelles initiatives qui favoriseront un développement forestier plus résilient et innovant. Ces autres activités peuvent être “la mycologie, l’élevage, la production de résine et même le tourisme”, illustre la Fondation.