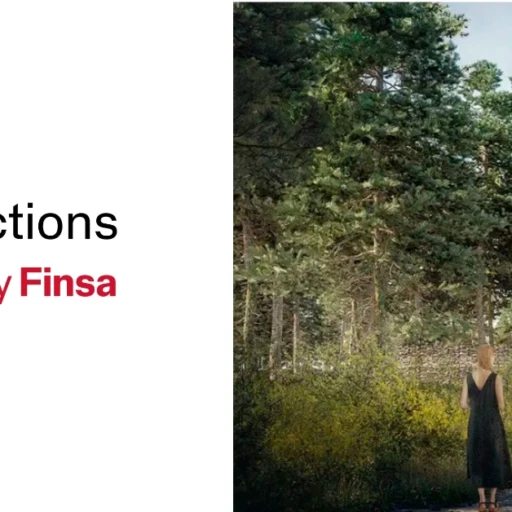Durant son enfance dans la Sierra de Mariola (Alicante), une région « de vergers, d’amandiers, d’oliviers, de maïs en été et d’un grand marché », Àlex Fenollar ne s’intéressait pas du tout à toute l’activité agricole de ses grands-parents. Il a étudié le journalisme et a travaillé un temps dans la publicité, puis un jour, il s’est soudain rendu compte que tout ce qu’il avait rejeté enfant était en réalité très beau. Par conséquent, il a changé de vie professionnelle et est devenu paysagiste.

Comment l’aménagement paysager est-il entré dans votre vie ?
Je dis toujours que c’est presque comme une vocation divine ; cela comporte de nombreux aspects vocationnels et inattendus, ce n’est pas une voie dont on ignore l’existence. Pour ceux d’entre nous qui ne viennent pas de familles ayant une tradition de jardinage ou d’aménagement paysager, c’est un processus de découverte de soi. Dans mon cas, cela a coïncidé avec la naissance de mon fils. Ce fut un moment de réflexion où je me suis dit : « Cet appel que je ressens pour la nature, pour le jardin, pour la campagne, peut-être pourrais-je en faire mon métier ». Tout a commencé, contre toute attente, de façon très hasardeuse, et j’ai tracé ma propre voie à une époque où l’aménagement paysager connaissait un essor considérable. J’y suis venu par vocation, par intérêt et parce que cela me passionne. Parce que je pense que c’est la plus belle chose au monde.
Vous vous définissez comme autodidacte, mais vous avez également une formation spécialisée. Comment pensez-vous que cela se mélange ou se traduit dans ce qui deviendra plus tard votre travail ?
C’est un métier qui peut être assez frustrant au début, car on découvre son existence et on ne sait pas par où commencer. Dans le cas de l’Espagne, il s’agit d’un problème structurel ; il n’existe pas de tradition paysagère qui lui ait donné un corps académique et une formation réglementée (même si cela a commencé à changer).
Mais, de plus, ce manque de définition est inhérent à la conception paysagère, qui est multidisciplinaire et comporte de nombreuses variables. En matière d’aménagement paysager, on trouve des gens issus des beaux-arts, des écrivains, des journalistes, des ingénieurs, des architectes, des agronomes… Il y a l’aménagement paysager davantage axé sur les travaux de génie civil, les piscines, le pavage, et puis il y a les paysagistes qui se consacrent à la restauration des forêts, quelque chose de très écologique. C’est un domaine tellement vaste qu’il est très difficile de trouver une carrière ou une formation qui le couvre entièrement. Ce qui m’intéresse le plus, c’est la partie qui a toujours été la moins abordée, celle de l’horticulture : les plantes, le matériel végétal, les communautés, comment utiliser une palette d’espèces dans un contexte local.
D’un autre côté, je souffre également de ce manque de confiance en moi et du syndrome de l’imposteur, c’est pourquoi j’ai suivi plusieurs formations, aussi bien en Espagne qu’en Angleterre. Mais je crois que l’essentiel réside dans l’auto-apprentissage, à la fois pratique et théorique. Un grand nombre d’ouvrages sur l’aménagement paysager sont publiés chaque année en Angleterre et dans d’autres pays, et constituent une source formidable de connaissances.

Comment ces connaissances sont-elles transférées au contexte local dans lequel vous travaillez ? Comment toute cette littérature, conçue dans une perspective anglaise, peut-elle être appliquée ailleurs ?
Nous devons toujours adapter nos connaissances en anglais à notre situation. Je dis toujours que je tiens des Anglais l’esprit, la vocation de jardinier : ils sont passionnés par le jardinage et il y a une motivation constante à s’améliorer, à créer des expériences de très haut niveau, à restaurer les paysages. Ce moteur est parfaitement adaptable. Ensuite, bien sûr, il y a des conditions très différentes, des climats très différents : il faut apprendre à remettre en question ce qui vient d’Angleterre. Par exemple, dans tous leurs catalogues de plantes, il y en a certaines qu’on appelle drought tolerant, tolérant à la sécheresse. Mais en Espagne, il ne s’agit pas de chercher des plantes tolérantes à la sécheresse, il faut chercher des plantes qui aiment la sécheresse. Hormis cela, il faut apporter ici la vocation, le désir, la méticulosité anglaise, en les associant à d’autres ingrédients. Le désir de créer des jardins immersifs où se succèdent, tout au long de l’année, des ponts d’intérêt, de plaisir et de connaissance… un désir que nous pouvons assurément concrétiser.
Vous parliez tout à l’heure de l’essor que connaît actuellement le design paysager. Quelle en est la raison selon vous ?
Bien sûr, la Covid a été un déclencheur immédiat, mais il y avait déjà un certain nombre d’architectes paysagistes qui transformaient la discipline. Les jardins ont toujours été des espaces clos en soi ; il y avait une grande différence entre jardin et nature. Le jardin était souvent composé de lignes géométriques, très forcées, très rationnelles, très humaines en contraste avec la nature. Au XXe siècle, les jardins ont émergé de cette coquille et une intégration beaucoup plus fluide entre jardin et nature a commencé. Je crois que l’engouement actuel pour l’aménagement paysager en Espagne et dans d’autres pays est lié à un besoin de renouer avec le monde naturel d’une manière domestiquée et interprétée.

Bien que l’on puisse penser que, puisqu’elle utilise la nature comme matière première, l’aménagement paysager est durable en soi, ce n’est pas le cas. Comment la durabilité est-elle intégrée à la profession ?
Les grands maîtres de l’aménagement paysager restent les Anglais, et l’aménagement paysager anglais tel que nous le connaissons date du XIXe siècle. Le résultat était d’un naturel et d’une harmonie exceptionnels, mais il impliquait des atrocités telles que la destruction d’un village entier parce qu’il obstruait la vue imprenable sur une vaste propriété. Les cours d’eau étaient détournés, l’écosystème était profondément bouleversé ; c’était une perturbation gigantesque. Il existe aussi des jardins qui ne sont absolument pas durables, car certains estiment qu’un jardin doit être beau, point final, même si cette beauté a un prix.
Cependant, les jeunes paysagistes naissent, grandissent et travaillent aujourd’hui dans un environnement tellement marqué par le changement climatique, par des menaces de toutes sortes, et face à un avenir si imprévisible que nous sommes durables : on ne nous demande pas de concevoir un jardin durable, nous l’avons complètement intégré. De plus, la beauté et la force de l’aménagement paysager contemporain résident dans le fait qu’il ne peut exister autrement que s’il n’est pas durable.
Vous parlez de changement climatique. Comment cela se traduit-il dans la pratique de la profession, quels changements cela implique-t-il ?
Le changement climatique est avant tout imprévisible ; ses schémas sont imprévisibles. C’est un défi constant qui nous pousse à expérimenter ; nous devons persévérer, être très flexibles et toujours garder un œil sur le jardin. Mais le jardinage, ce regard porté sur le jardin : c’est le changement, c’est l’évolution, c’est l’édition. La seule chose qui reste inchangée, c’est un escalier.

En collaboration avec Enorme Studio, vous êtes responsable de la conception de la salle de bains Forest, l’espace de Finsa au Madrid Design Festival 2026. Comment avez-vous développé le projet ?
Enorme Studio, dont les membres sont des amis et des collègues, m’a parlé de cette idée de créer une installation éphémère avec des produits Finsa et en utilisant le concept du livre Walden, de Henry David Thoreau. Ils m’ont demandé : « Comment recréer une forêt à Madrid ? », et je leur ai répondu que les paysagistes s’inspirent toujours des écosystèmes présents dans la nature. Nous avons décidé d’adopter le concept de forêt et de sous-bois, où la lumière filtre à travers les arbres, et nous avons imaginé une excursion à travers Guadarrama ou Gredos, à travers une forêt humanisée ; c’est pourquoi une plateforme apparaît pour créer un chemin forestier. Nous souhaitions créer une immersion, un bain dans la forêt indigène qui puisse aussi représenter une double immersion, dans le jardin et dans le livre, deux contextes où le temps semble suspendu. On y entre tout en restant dans le monde réel, mais simultanément on est séparé, ou du moins dans un autre monde.

De quel projet êtes-vous le plus fier ?
Aujourd’hui, je crois que l’un des plus beaux jardins se trouve dans le Baix Empordà catalan, à Gérone. C’est une de ces rares occasions où l’architecte paysagiste peut au moins intervenir dans l’ensemble du contexte, dans la totalité de l’ensemble : pavage, menuiseries extérieures, plantations… Le contexte est par ailleurs ravissant. Dans l’Empordà, il y a une grande noblesse des matériaux, quelque chose de très harmonieux. Les clients nous ont laissé carte blanche et le résultat est un jardin qui a très bien évolué. Il offre des moments très photogéniques et très spéciaux de la fin du printemps au début de l’été, même s’il s’agit d’un petit jardin.

Qu’est-ce qu’un bon jardin pour vous ? À quelles règles doit-il se conformer ?
Il doit être cohérent avec l’environnement et bien intégré. Si l’environnement est favorable, c’est fantastique, vous réagissez à cet environnement, vous l’ouvrez et vous le reproduisez en vous. Si l’environnement est mauvais, on s’enferme dans un monde à part. C’est toujours une réponse au contexte. Pour moi, un mauvais jardin est un jardin qui introduit des éléments étrangers au lieu, une imposition sur le papier qui ne trouve ensuite aucune réponse matérielle, physique ou spirituelle dans le contexte.
À quoi ressemble une journée type pour un concepteur paysagiste ?
Ce qui est bien avec les paysagistes, c’est que nous alternons entre des journées d’études intensives, passées principalement sur ordinateur, et des journées où nous avons la chance de pouvoir aussi travailler sur la création, la conception et la concrétisation de tout cela. C’est un changement énorme pour ceux d’entre nous qui, auparavant, ne nous consacrions à rien de matériel ni à rien de créé, mais où tout évoluait plutôt sur un plan abstrait.
En tant que paysagistes, une bonne partie de notre travail se traduit par une réalité physique que l’on peut respirer, toucher et sentir. C’est une chance incroyable, car on sait que tout le travail et tous les tracas que l’on rencontre finissent par aboutir à au moins un moment magique : cette visite, un an ou deux plus tard, lorsqu’on entre dans le jardin en mai, qu’il a été bien entretenu et qu’on se dit : « Tout cela existe maintenant, on peut en profiter ».